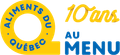Conversation autour du métier de critique culinaire avec Jean-Philippe Tastet
De l’amour des lettres à l’amour de la restauration en passant par mille et une rencontres, conversation avec le critique culinaire Jean-Philippe Tastet autour d’un café espresso.
Il est 8 heures du matin, un café à la main, toujours le même depuis 10 ans, celui de sa machine Jura qu’il n’échangerait pour rien au monde.
Parce que s’il y a bien une chose que le critique a apprise de sa carrière, c’est la constance de qualité qui surpasse tout autre chose, et cela, dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit son premier café du matin ou bien la constance de qualité dans son assiette au restaurant, Jean-Philippe sait de quoi il parle.
Jean-Philippe Tastet nous emmène dans les coulisses de l’industrie de la restauration et nous donne sa perspective avec la même modestie et justesse qu’il a su entretenir pendant toute sa carrière.
Quel est votre premier souvenir de la cuisine ?
J’ai été élevé dans un tout petit village dans le sud de la France et je me rappelle que je suivais ma mamie quand elle faisait la cuisine, j’étais vraiment impressionné. Je me disais, c’est bizarre, le lapin qu’on a attrapé il y a deux heures, il est dans notre assiette maintenant et c’est super bon. Je me suis intéressé tout de suite à la raison derrière ça et très vite j’ai aimé cuisiner.
Il faut savoir aussi que dans la France profonde, il y a une cinquantaine d’années, le mot gastronomie n’existait pas, c’était de la cuisine populaire. La gastronomie existait à Lyon et dans deux ou trois endroits en France, mais dans ma campagne ça n’existait pas. Dans la ville la plus proche, Cahors, la préfecture du Lot, un restaurant, c’était un restaurant français, pas italien, pas japonais, pas autre chose que français. Ce n’est que bien plus tard que la gastronomie internationale s’est développée.
Quel parcours pour devenir critique ?
J’ai fait « l’école normale » pour devenir enseignant au primaire et je suis parti travailler à la Nouvelle Orléans en Louisiane ; ensuite, je suis allé à Téhéran au moment de la révolution. Je suis parti de l’Iran lorsque la guerre avec l’Irak a commencé et j’ai atterri à Toronto, Ontario. J’ai enseigné à Toronto surtout aux adultes parce qu’il y avait une commission du gouvernement qui s’appelle Services en langue française et j’ai enseigné à des hauts fonctionnaires. Je suis venu à Montréal lorsque j’ai rencontré, à Toronto, la maman d’Élise qui était aux études ici et j’ai commencé à faire des traductions pour Le Devoir.
N’est venu que plus tard le premier contact avec la cuisine. J’ai accompagné, pendant longtemps, mon amie Josée Blanchette qui était critique de restaurant au Devoir et quand elle a arrêté, elle m’a dit : « il me semble que tu aimerais ça toi ». Je lui ai répondu en rigolant : « Non j’aime ça aller au restaurant avec toi parce que tu ne manges presque plus rien donc je mange mon assiette, je mange la tienne, c’est toi qui payes, on sort du restaurant et je n’ai rien à faire ». Mais elle a quand même donné mon nom au directeur du Devoir qui m’a appelé et j’ai commencé à écrire dans le devoir dès cet instant. Je suis resté chez eux une vingtaine d’années, 25 ans, avec une pause peut-être d’une dizaine d’années pendant laquelle j’ai pris la direction de quelque chose qui existait à l’époque qui s’appelait le Guide Resto Voir.
Honnêtement j’ai toujours aimé faire la cuisine et j’ai développé un certain goût, un certain bon jugement, je pense pour le travail d’un restaurant, derrière en cuisine et devant en salle. Ça ne veut pas dire que j’ai tout compris, loin de là, mais j’ai compris certaines choses. J’ai toujours été très admiratif du travail de ces gens-là.
Ma carrière de critique, c’est d’abord l’amour du français et puis un amour de la cuisine qui s’est développé, mais c’est surtout une histoire de rencontres.
Qu’est-ce que vous aimez le plus de l’industrie de la restauration ?
Beaucoup de choses en fait, j’aime notamment la passion des gens qui sont en cuisine. En salle, il y en a bien sûr, mais moins, c’est un métier qui est un peu galvaudé, les gens vont travailler au service dans les restos parce qu’ils gagnent pas mal d’argent, mais il y a peu de personnes qui sont là par véritable amour du métier, du service. Mais, là aussi, il y a des exceptions et des personnes dévouées, passionnées et qui sans cesse cherchent à offrir un service toujours meilleur. Je pense à Fanny Alaizeau chez h3 que je vois évoluer dans sa profession et qui aujourd’hui offre une prestation exceptionnelle après avoir suivi son cours de sommellerie à l’ITHQ un exemple à suivre.
J’aime beaucoup la passion des gens en cuisine, j’aime beaucoup l’inventivité. C’est une sorte de don de soi. Nourrir quelqu’un c’est un acte de générosité et je trouve que les gens sont super inventifs et on s’entend tous pour dire qu’on ne vit pas dans un climat ici qui se prête à la créativité à longueur d’année. Un chef qui habite à Perpignan et qui cuisine bien, qui propose des trucs intéressants au mois de février… Ok, bravo, c’est super on apprécie et je pense que tout le monde aime ça, mais le chef qui, ici, au mois de février réussit à faire des assiettes intéressantes. Mille fois bravo !
La différence selon vous entre la gastronomie française et québécoise ?
Je dirais la décontraction. Mais attention ! La décontraction, ça ne veut pas dire le détachement, ça veut juste dire que les gens ne se prennent pas la tête. Ils sont très appliqués, très méticuleux. Comme tous les gens qui sont passionnés, ils se donnent à leur tâche, mais ils sont beaucoup plus relax et il me semble qu’il y a moins de barrières. Un gratin dauphinois en France, si la recette dit A, B, C, D, tu la suis au pied de la lettre. Si tu changes, c’est plus un gratin dauphinois, ils disent « un gratin dauphinois à ma façon ».
Des rencontres qui vous ont profondément marqué dans votre carrière ?
Je me souviens qu’il y a des rencontres avec des grands noms. Je me souviens que j’ai partagé un repas avec Monsieur Bocuse et c’était très impressionnant. Il y a des rencontres avec des chefs qui sont impressionnantes, car ces personnes te marquent par leur personnalité. Je me souviens de discussions avec Alain Ducasse ici où c’était vraiment marquant, même chose avec Pierre Gagnaire, avec Joël Robuchon, ces grands chefs ; notamment avec les chefs français parce que c’est plus facile pour moi d’avoir une conversation très creusée avec des Français. Mais il y a aussi plein de petits établissements qui marquent. Sur l’avenue du Parc par exemple il y a un tout petit restaurant qui s’appelle Barcola, c’est un de mes endroits préférés. Le chef travaille super bien, sa femme offre un service chaleureux en salle. Fabrizio, le chef, est un amoureux de jazz, il y a toujours de la super bonne musique, ils ne se prennent pas la tête. C’est comme à la maison, mais en mieux.
Il y en a d’autres, des gens très impressionnants comme David McMillan et Frédéric Morin qui ont monté leur empire dans la Petite-Bourgogne et qui en ont fait un endroit magnifique. Plein d’autres gens comme ça, des jeunes qui sont déjà éblouissant.e.s.
J’aime aussi beaucoup l’émergence des cheffes. Il faut se reporter 50 ans en arrière, ça n’existait pas. Il y avait la mère Brazier, à Lyon, en France, mais au Québec je ne m’en souviens pas. Anne Desjardins a été une pionnière, mais c’était presque exclusivement un métier d’hommes. Or, aujourd’hui, il y a bien des cheffes qui gèrent leur cuisine extrêmement bien et qui font un travail extraordinaire.
Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a profondément marqué ?
Pas une personne en particulier, je dirais que j’ai beaucoup appris en posant des questions, en étant curieux, en allant en cuisine… C’est toujours en rapport avec la curiosité des gens. Il faut toujours creuser. Dernièrement je suis passé chez Yoann Van Den Berg au Pastel et, à Québec, chez Stéphane Modat à son nouveau restaurant Le Clan et, aux deux endroits, c’était phénoménal comment les assiettes étaient construites. Je ne me lasse jamais de demander « Comment vous avez réussi à faire ça ? »
Qu’est-ce qui fait un bon chef et qu’est-ce qui fait un bon restaurant ?
Alors premièrement un bon chef, c’est avant tout un bon cuisinier… mais un bon cuisinier n’est pas forcément un très bon chef. Un bon chef sait gérer une brigade, une équipe, c’est lui mène la danse avec doigté. Pour moi un bon chef, c’est un bon cuisinier et une bonne personne.
Je me souviens être allé au restaurant à une table en cuisine avec nos enfants quand ils étaient plus jeunes et quand on est rentrés à la maison, je leur ai demandé ce qui les avait le plus impressionnés. Ils ont dit : « on est restés 4 heures à table et personne n’a levé la voix en cuisine. » Ça, c’est de la très bonne gestion. Un bon restaurant, ça part de la cuisine et comment le travail impeccable de la cuisine est servi parce qu’il faut qu’il y ait un équilibre entre les créations de la cuisine et le travail qui est accompli devant. C’est un ensemble. Ce sont les gens en service qui connaissent le menu, qui savent ce qu’ils doivent servir. Le service du vin prend de plus en plus d’importance donc c’est quand même agréable d’avoir à défaut d’un sommelier, quelqu’un qui sait de quoi il parle.
Un exemple de restaurant qui défie toute concurrence dans sa catégorie, c’est L’Express qui donne la même qualité de cuisine et de service depuis son ouverture. Au départ de Joël Chapoulie, l’immense chef qui a tenu les rênes de L’Express pendant des décennies, l’arrivée du nouveau chef, qui n’est d’ailleurs plus nouveau maintenant, Jean-François Vachon, a été un tournant intéressant puisqu’il a été capable de comprendre que sa créativité à L’Express serait justement de ne pas faire preuve de créativité parce que les gens viennent en toute confiance à L’Express pour manger les mêmes plats. Du 1er janvier au 31 décembre, si tu veux aller manger un foie de veau à l’estragon, ça sera toujours la même chose. La constance de qualité !
Après il y a des restaurants plus créatifs qui font un travail exceptionnel également, que ce soit Pastel à Montréal ou Le Clan à Québec, il y en a plein d’autres…
Votre plus belle expérience de travail et la pire ?
Ma plus belle expérience a été de garder jusqu’à la dernière critique que j’ai publiée dans Le Devoir, le même intérêt, la même bienveillance envers tous ces gens qui travaillent très fort en restauration.
La pire, je dirai que c’est une série de mauvaises expériences. Écrire sur la cuisine asiatique, c’est pour moi très difficile parce que c’est une cuisine que je ne connais pas du tout. Donc les premières critiques que j’ai écrites, j’ai passé des heures et des heures dessus à essayer d’écrire, à lire, à appeler des gens, etc. Trop de travail, ce n’est pas agréable.
Comment décririez-vous votre carrière de critique ?
Un travail de plaisir. Parce que le mot travail vient avant le mot plaisir. C’est beaucoup de travail, beaucoup de recherches. Les gens ne se doutent pas du travail qui est derrière.
Je n’ai jamais eu aucun plaisir à écrire une mauvaise critique, ce n’est pas agréable, mais honnêtement en 25 ans de métier, les mauvaises critiques, je les compte sur les doigts d’une main. Je pense que c’est un métier où il faut faire preuve de bienveillance.
Si Jean-Philippe Tastet baigne depuis 25 ans maintenant dans la restauration et est devenu un expert du domaine. Le goût des bonnes choses qu’il a affiné et entretenu pendant toutes ces années s’est étendu au café, petit plaisir de son quotidien. Selon lui, les machines JURA de chez Édika sont comparables à aucune autre sur le marché. Rituel-matin avec Jean-Philippe Tastet.
D’où est né votre amour pour le café ?
Dans mon enfance, avec mon grand-père. Je l’ai toujours vu boire du café alors je suppose que cela m’est venu naturellement par la suite.
Quand je suis arrivé à Montréal, j’aimais beaucoup aller me ravitailler en grains au café au coin de la rue, Le propriétaire, Asped Istanboulian, me faisait goûter toutes sortes de cafés torréfiés. J’aime ces échanges, le rapport humain et c’est grâce à lui que j’ai eu cette machine de la marque JURA qui m’accompagne fidèlement depuis, je crois, une douzaine d’années.
Qu’est-ce que vous préférez des machines JURA de chez Édika ?
Le plaisir de goûter différentes torréfactions, différentes origines et c’est ce que permettent les machines JURA. Selon moi, c’est l’une de leurs très belles qualités, ce sont des machines qui permettent des découvertes. Elles ont plein d’autres qualités ; on appuie sur le bouton et le café est prêt, c’est extraordinaire, un peu comme la Suisse.
Les machines, c’est bien, mais le service ça l’est tout autant et celui offert par les gens de chez Édika est à souligner. Accueil, suivi, entretien des appareils, clarté des explications du personnel, tout est très soigné. Il faut voir les techniciens travailler sur les appareils derrière la baie vitrée à l’arrière du comptoir d’accueil, c’est formidable, on se croirait dans un puits de Formule 1.
Écrit par Inès Duguen